| Sommaire historique |
Le 18ème et 19ème siècle (Vers une activité agricole)
L'évolution des dernières années
Le cahier de doléances du 6 mars 1789
 |
D'or à la bande de gueules chargées de trois coquilles *
d'argent, une crosse de gueules posées en barre brochant sur le tout.
Les coquilles sont l'emblème de la ville de Sierck, chef-lieu d'une prévoté lorraine dont faisait partie APACH ; la crosse rappelle que l'abbaye de Saint-Sixte de Rettel a possédé autrefois la localité. *http://www.saint-jacques.info/blasons.html
|
Apach est citée
pour la 1ére fois en 1084 dans la chronique de l'abbaye de Rettel sous le nom
d'Achabach. La première mention certaine d'Apach se trouve en 1158 dans l'acte
par lequel Mathieu 1er de Lorraine accorde aux religieux de Bouzonville le
patronage de l'église et les dîmes du village. On trouve par la suite dans les cartes d'époque et d'autres
documents Aspach en 1196, Akebach en 1319, Appach en 1495, 1583, 1594, Opach en
1682, Auppach à la fin du 17ème siècle, Aspach en 1756.Lors de l'annexion de
1870, le nom du village reste Apach, forme qu'il acquiert à la fin
du 18ème siècle.
Le véritable nom d'Apach, celui employé par la population francicophone
du village est Opéch avec l'accent tonique sur le O long fermé initial.
C'est le ruisseau qui venant de Manderen coupe le village pour se jeter
dans la Moselle une centaine de mètres plus loin, qui a donné son nom à Apach.
On l'appelle d'ailleurs en français "ruisseau d'Apach" et en
langue francique "d'opécher baach" ou tout simplement "d'Opéch".On
peut en effet découper le nom Apach en deux éléments. Pach est une variante
de Bach et signifie ruisseau. Le préfixe A- nous vient de l'époque
celte."A" signifie en effet en vieux celtique:la limite, la frontière.
Apach signifie donc "ruisseau frontière".Il ne s'agit bien entendu
pas de la frontière actuelle qui n'existait pas à l'époque celtes, mais de la
frontière entre deux tribus celtes: les médiomatriques au sud et les trèvires
au nord. Cette frontière se trouvait justement délimitée à cet endroit par ce
ruisseau. Apach, terme d'origine, a évolué ensuite en francique en Opéch, vu
qu'un "A" long tonique se transforme en "O" long
et que le "A" atone s'est transformé peu à peu en une voyelle
atone:
"Autrefois, aux frontières de la Gaule vivaient les Germains. Notre
pays au climat tempéré les attirait.
5OO ans après J.C. une bande franque se réunit pour tenter l'Aventure
et passer la frontière. Avant de partir, les guerriers se donnaient un chef.
Aussitôt l'élection de celui-ci, ils ont franchi le Rhin sur des radeaux. Les
guerriers ne partaient pas seuls, mais avec femme, enfants et tous leurs biens.
Sur l'un des chariots il y avait une belle femme qui s'appelait Acha.
 |
Au cours du siège devant Hettange-Grande, le mari d'Acha a été blessé grièvement par une flèche |
Après le combat perdu par cette horde, ils se sont remis en route sans savoir vers quel lieu ils se dirigeaient. Ils ont marché jusqu'au soir et se sont arrêtés près d'un petit ruisseau où ils se sont désaltérés, et où ils sont restés pour se reposer. Ils se trouvaient très à l'aise dans cette vallée entourée de collines et de forêts.
 |
Ils trouvaient le site si merveilleux qu'ils ont décidé d'y rester. La construction de cabanes n'était pas une affaire d'état et leur installation était rapide. |
Un nom avait été donné à l'endroit où ils s'étaient fixés, et il
s'appelait alors Acha-am-Bach, qui signifie Acha-près-du-Ruisseau."
-le 1/3 de la somme totale fixée, suivant les droits et dus de chacun,
par l'abbé
et ses compagnons;
-le 1/3 des sommes perçues par suites d'amendes infligées aux Achabadois
pour vols de brins d'osier, adultères qu'on avait découverts, révoltes et
dommages causés aux bornes limitant les champs;
-un mouton, quatre fois 26 litres de vin et huit pains, à Pâques ou à
la Saint-Jean.
D'autre part, le bailli percevait à Noël, de chaque habitant, une obole
fixée comme suit:un demi-pain et un bichet(26 litres) d'avoine.
En 1565, Apach est cité par Expilly comme étant un tout petit village
de 12 feux ( 60 habitants ).
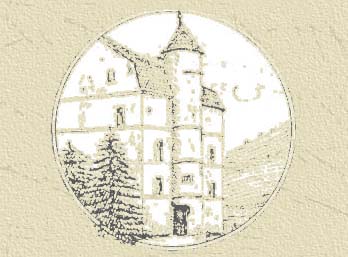

Il y avait à Apach un château, construit vers le milieu du 16ème siècle
au bord du ruisseau qui se jette dans la Moselle non loin de là; il avait l'aspect
d'une maison bourgeoise de l'époque. C'était une bâtisse carrée en pierres
meulières, ayant trois étages, surmontée de mansardes, percée de fenêtres
à meneaux et flanquée d'une tour ronde. Chaque étage était accusé par une
rangée de pierres de taille faisant tout le tour de la maison. A proximité et
à l'emplacement des anciennes tanneries Gillard se trouvait le moulin bas. Le
château, endommagé pendant la guerre de Trente Ans, et reconstruit en 1671, a
été démoli en 1924 quand on procéda à la construction de la nouvelle
gare.
L'existence du minerai de fer était connue aux environs de Sierck dès
le 16éme siècle. En 1565 un certain Loys La Ricque, « ingénieur des mines de
fer » , fut chargé par le duc de Lorraine de rechercher les filons.
Le minerai fut-il trop peu abondant
pour alimenter une forge ?
Nous le supposerions volontiers ; car on
ne trouve pas trace de l'établissement d'une forge à Sierck ; ce fut à Apach,
qu'une forge fut installée dès le commencement du 17éme siècle.
Pour s'expliquer comment le propriétaire
censier d'Apach fut amené à y établir de grosses forges, c'est-à-dire
des forges ou non seulement on travaillait le fer, mais ou on l'extrayait du
minerai, il faut se reporter aux procédés métallurgiques de l'époque.
Pour de grosses forges il fallait: 1 °
du minerai ; 2° de l'eau ; 3° du bois ; 4° de la main d'oeuvre.
Le minerai existant en trop petite
quantité dans les environs d'Apach pour alimenter de grosses forges, le propriétaire
des forges, M. de Bettainvillers , le faisait venir du pays de Moyeuvre déjà
centre minier à cette époque. On trouvait à Apach les deux autres facteurs
essentiels ; le bois qui constituait la grosse dépense du travail métallurgique
, et l'eau.
Le bois servait , après avoir été
transformé en charbon , pour le haut fourneau, la fonderie et pour la forge.
Une grosse forge en faisait une consommation énorme ; il fallait une
main-d'oeuvre considérable pour le préparer. Bûcherons et charbonniers
travaillaient d'une manière presque incessante, selon la saison, en plus grand
nombre que les métallurgistes.
L'eau servait à laver le minerai ainsi
qu'à faire mouvoir les machines‑outils. L'eau actionnait les souffleries,
les marteaux, les martinets. A Apach , la proximité de la Moselle facilitait
les expéditions d'objets fabriqués et les apports de matières premières, le
minerai.
Quelle était l'importance des forges d'Apach
? Nous y trouvons à la fin du 17éme siècle une dizaine d'ouvriers, produisant
500 livres de fer par jour et 100 livres de tôle.
Les
forges d'Apach constituaient un ensemble industriel ni plus grand, ni plus petit
que les usines analogues.
En 1609, le 15 août et, en 1611, le 11 mai, Henri, duc de Lorraine, vend
à Louis de Bettainvillers, maître des forges de Moyeuvre, le bois de
Kadenbusch, au ban de Kemplich, et une partie des bois de Schwarzbruch et de
Saint-Martinsholtz, du côté de Sierck et des villages de beschtorff (Büschdorf)
Efft et Hellendorf (près de Perl), à condition que ledit Bettainvillers enlève
toute la charmille et d'autres branchages pour la convertir en charbon de bois
pour ses fourneaux. Le duc lui permet, à lui et à ses hoirs, de prendre mines
de fer à environ quatre lieues à la ronde ou plus proche dudit Sierck, s'il en
trouve et sous ses hautes justices pour y ériger fourneaux et édifices à
forger fer et de faire des cours d'eau qu'il trouvera propres audit effet,
etc...
Les fourneaux dont il est question sont les meules à charbon de bois. M.
de Bettainvillers se propose d'ériger des forges et de faire des aménagements
hydrauliques. C'est la fondation des forges d'Apach. Il pourra prendre des mines
s'il en trouve. Il n'en trouva sans doute pas suffisamment, puisqu'il fit venir
son minerai de Moyeuvre et d'Aumetz. Quant à la main-d'œuvre, elle venait du même
pays que le minerai car les habitants du village n'étaient pas suffisamment
qualifiés pour le travail. Et de plus, les ouvriers des grosses forges étaient
des artisans jaloux des secrets de leur métier. Ceci a pu être vérifié car
tous les ouvriers du pays de Moyeuvre portaient des noms français.
Étant donné les moyens de communication de l'époque, les ouvriers
n'avaient pas le choix, ils devaient s'installer avec leur famille à l'endroit
où ils travaillaient.
On y fabriquait les
articles suivants : plaques de foyer barres de fer tôles bombes enclumes rampes
grilles balcons piques haches pioches
etc...
Entre
autres articles fabriqués aux forges d'Apach , nous mentionnerons quelques
plaques de foyer fondues en 1685 mesurant 76cm de largeur sur 67 de hauteur.

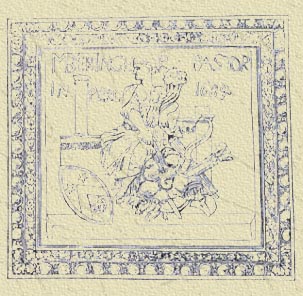
Une
grosse forge occupait une douzaine d'ouvrier. Les mouleurs et les forgerons étaient
de véritables spécialistes contrôlés par le directeur des forges qu'on
nommait, en ce temps-là, le facteur de la forge.
Pendant
cette période, les forges changèrent très souvent de propriétaire. Le développement
de forges mieux situées (par rapport aux mines de fer), facilement approvisionnées
en bois, charbon et minerai a contribué au déclin rapide de la forge d'Apach.
Elles ont cessé toute activité en 1732.D'elles il ne reste plus rien si ce
n'est les noms évocateurs de "Weiher", "Platinerie",et
" rue des Forges"au niveau toponymique.
A la même époque la verrerie établie dans le village cessa également
de fonctionner.
Le
28 février 1661, par le Traité de Vincennes, Charles IV, duc de Lorraine céda
au roi Louis XIV la ville de Sierck et une trentaine de villages environnants.
C'est ainsi qu'Apach devint français, 105 ans avant la Lorraine. Apach devint
alors siège d'une mairie dans le cadre de la prévôté de Sierck qui englobait
la vallée d'Apach, c'est-à-dire les localités d'Apach, Huvertingen, Belmach,Tünting,Ritzing,Merschweiller
ainsi que Besch et autres petites localités du côté sarrois.

Blason de Nicolas Thierry de St Baussant
Presque
aussitôt après cette période de splendeur relative, la forge d'Apach traverse
de nouveau des moments difficiles. La guerre devait éloigner M de St Baussant
de son usine. En 1690 c'est Isaac Levy, qui s'efforce de la maintenir en activité.
Mais Levy ne paraît pas avoir tenu ses engagements et en 1691 la forge fût
prise à bail par Nicolas Collin. A la fin avril 1694 la forge fut adjugée à
un certain Alexandre Huguenin
Mais
Huguenin n'avait pas l'intention de mettre à feu le fourneau et donc de faire
du fer à Apach. Il voulait seulement faire façonner les gueuses qu'il faisait
dans la forge de Moyeuvre. Différentes affaires juridiques, ajoutées aux maux
de la guerre, qui avaient ravagé tout le pays avec une barbarie extrême,
expliqueront l'état lamentable ou était tombé la petite usine. La forge d'Apach
fût adjugée le 4 mai 1699 à Charles Feticq , seigneur de Cussigny, et Antoine
Gaudet son gendre. Mais les conditions d'exploitation n'étaient plus les mêmes,
ils n'étaient propriétaire que des forges et ne possédaient ni bois ni
minerai, qu'ils devaient acheter.
Entre autres articles fabriqués aux forges dApach, des
plaques de foyer fondues en 1685. Ces plaques offrent les noms ou les initiales
des personne qui les avaient commandées.
Pourtant
la forge était loin d'être inactive. Les ouvriers qui y travaillaient venaient
principalement de Villerupt, pays des forges. Les forges d'Apach sont
constamment vendues et revendues ! 1732 ; puis 1739 ; 1741. En 1752 elles
changent encore de maître.
En
1756 , dans un traité du département de Metz , on peut lire, en parlant du
village d'Apach , qu'il y avait une forge tombée en ruine , entendu que les
mines de fer étaient trop éloignées. Le développement des forges voisines ,
mieux situées, facilement approvisionnées en bois charbon et minerai dut
contribuer au déclin rapide de la forge d'Apach.
A la même époque la verrerie établie dans le village cessa également
de fonctionner.
En 1639,Apach se trouvait être avec Kirsch et Merschweiller comme
"bien" mis en gage à un Seigneur Morrbach, mais paraît avoir été
rapidement racheté.
A la fin de 1649, l'armée française commandée par Rosen et La Ferté-Senneterre,
puis au printemps de 1650 celle de Lorraine sous les ordres du comte
Philippe-Emmanuel de Ligniville dévastèrent le pays à nouveau.
Le 28 février 1661, par le Traité de Vincennes, Charles IV, duc de
Lorraine céda au roi Louis XIV la ville de Sierck et une trentaine de villages
environnants. C'est ainsi qu'Apach devint français, 105 ans avant la Lorraine.
Apach devint alors siège d'une mairie dans le cadre de la prévôté de Sierck
qui englobait la vallée d'Apach, c'est-à-dire les localités d'Apach,
Huvertingen, Belmach,Tünting,Ritzing,Merschweiller ainsi que Besch et autres
petites localités du côté sarrois.
Au printemps de 1667,l'armée de Créqui traverse le pays. De 1672 à
1677, Condé et Turenne ainsi que le duc de Lorraine campent avec leurs armées
tour àtour dans les environs.
Le 18ème et 19 siècle ( VERS UNE ACTIVITE AGRICOLE
)![]()
La pomme de terre fut introduite à Apach en 1766 (reçue de la
Chartreuse de Rettel elle-même ayant reçue ce légume de Hannovre).
Apach devint commune en 179O, compte 305 habitants,48 maisons, et 4
moulins ( un à écorce, une scierie, deux huileries )et n'a cessé de se développer
à partir de cette date.
Les forges n'existaient plus mais à leur place, il y avait de nombreux
troupeaux.
L'activité est alors essentiellement agricole. A côté de l'élevage,
les villageois s'adonnaient à la vigne qui remplissait le coteau du Hammelsberg
avantageusement tourné vers le soleil.
En 1812,un décret du 30 mars, rattache Apach à la commune de Kirsch et
le fut jusqu'au 12 janvier 1833.
Une statistique de 1844, signale une population de 537 habitants et un
total de 90 maisons. Il y a une école allemande et française que fréquentent
63 garçons et 53 filles ( revenus de l'instituteur 500 francs ),une église
neuve, un presbytère, une maison d'école. Le territoire productible est de 137
hectares de terrains en friche dont le tiers a été mis en culture depuis 1836,
8 hectares en vigne de raisins blancs,5 hectares de prairies le long de la
Moselle et près du ruisseau, 24 hectares en bois et 50 hectares en terres
labourables ou jardins. Il existe également à l'époque près de la Moselle
une source d'eau salée ferrugineuse dont la propriété est d'être purgative.
elle marque 12°C tandis que les autres fontaines ne marquent que 10°C. Le
village comprend alors, six moulins dont un mécanique et trois à tan, alimentés
par le ruisseau qui parcourt la commune, une huilerie, deux fafriques de pipes
en terre occupant 15 personnes, trois tanneries.
Sous
Napoléon III, la France s'enrichit grâce aux découvertes scientifiques qui
bouleversent l'agriculture, l'industrie et le commerce.
Ce développement industriel attire du monde à Apach, et on comprend
ainsi pourquoi la courbe démographie s'accentue de 1849 à 1864.
Mais dès 187O, la guerre vint à nouveau semer l'horreur parmi des
habitants d'Apach.
Les
conditions de la guerre de 187O furent désastreuses pour notre petit pays. Les
personnes le quittèrent pour s'en aller vivre en vieille France.
La première guerre mondiale a fait une vingtaine de victimes mais dès
1919, Apach connut de sérieuses transformations. De 1919 à 1934, on
construisit beaucoup à Apach.
Un cordon douanier s'établit de nouveau à la frontière allemande, tel qu'il existait avant 187O.
Comme il fallait loger le personnel de douane, on construisit une cité
douanière, soit une dizaine de maisons semblables les unes aux autres.
Les douaniers étaient originaires, pour la plupart, de la Bretagne, du
Jura et des Vosges. De plus, la gare frontière devint poste de de contrôle
pour le transit international.
On transforma complètement l'ancienne gare construite par les Allemands en 19O5. Pour loger les employés du chemin de fer, originaires du centre de la France pour la plupart, on construisit la cité Bellevue qui domine le vieux Apach.
Un article de journal du 26.7.1930
| La grande colonie de cheminots entre Apach et la
frontière prussienne
Comme nous l'avions annoncé dans notre article paru hier sous la rubrique de "Sierck", la grande colonie de cheminots, construite sur la hauteur, entre Apach et la frontière prussienne, est entièrement terminée. Plusieurs ménages s'y sont installés déjà, et tous les logements seront occupés pour le 1er octobre prochain, c'est à dire dans quelques jours. Cette colonie-qui est un modèle du genre-est composée de 26 doubles maison, soit au total : 52 logements. Trente-quatre de ceux-ci comportent chacun quatre pièces et une cuisine ; les dix-huit autres : trois pièces et une cuisine. Deux rues traversent parallèlement la colonie : l'une porte le nom de rue de Belmach, qui est le nom d'un écart d'Apach, et l'autre, celui de rue Belle-vue. Il ne pouvait être mieux choisi, car de cette éminence, la vue s'étend au loin sur la magnifique vallée de la Moselle et les rives luxembourgeoise et rhénane. .
|
Les appartements sont fort bien agencés-tapissés et plafonnés avec une simplicité qui n'exclut pas le bon goût. Ils comportent l'électricité, l'eau et des installations hygiéniques adéquates. Chaque occupant dispose d'un jardinet de près de trois ares. A gauche de la grande entrée de la colonie, on aperçoit un vaste terrain de cinquante ares avec quelques bancs. Ce terrain doit servir de parc de jeux aux enfants L'ensemble du terrain comporte une superficie totale de 6,5 hectares. Dans un avenir qui n'est pas éloigné, il y sera construit en outre 34 logements pour employés des douanes. On prévoit également l'installation de plusieurs maisons de commerce aux abords de cette colonie, car par les mauvais temps, en hiver notamment, il serait très désagréable aux ménagères d'avoir à descendre jusqu'au village pour s'approvisionner. | L'établissement de cette colonie
impose à la commune d'Apach un grave problème dont nous avons souligné
l'urgence déjà : celui de l'agrandissement des écoles de garçons et de
filles. Ce problème ne peut plus être différé, et il faut que le
Conseil municipal sache bien que si les ressources communales sont
notoirement insuffisantes-ce qui n'étonnera personne-il pourra compter
sur le concours effectif de l'Etat et de la Direction des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine. Ce qui a pu être fait à la colonie de
Basse-Yutz, est également réalisable à Apach.
En attendant, nous saluons avec une vive satisfaction cette colonie nouvelle qui vient en quelques mois de surgir de terre, si l'on peut dire, et qui constitue un incontestable progrès social. |
Durant cette période, la population augmenta rapidement. Le village
comptait en 1938, 698 habitants. Apach connut par conséquent à cette époque
une forte immigration. Les immigrants étaient essentiellement des personnes
ayant quitté des régions pauvres de la France où le travail leur manquait.
Mais ceci ne devait pas durer, car à nouveau la guerre amena misères et
destructions dans notre localité.
Apach connut à nouveau la misère après la 2ème guerre mondiale. En
effet, tous les habitants durent évacuer brusquement le village le 2 septembre
1939, laissant derrière eux tout leur avoir et leurs biens amassés péniblement
durant des années. Les évacués ont été à Rouillé, village situé dans la
Vienne. Maintenant le village faisait
partie de ce No Man's Land qui s'étendait entre les lignes Maginot et Siegfried.
Presque toutes les maisons furent atteintes. Un vingtième disparut complètement.
La gare elle aussi, connut de gros ravages. Après l'armistice en
septembre-octobre 194O, 35O habitants rentrèrent à Apach.
En
1946, Apach n'avaient plus sa population d'avant guerre et il faudra attendre
1955 pour que le village retrouve son équilibre.
L'EVOLUTION DES
DERNIÈRES
ANNÉES
C'est dans les registres paroissiaux qu'on retrouve habituellement les noms des personnes qui ont habité le village autrefois. Mais comme Apach faisait partie de la paroisse de Perl avant la révolution, il n'existe pas de registres paroissiaux d'APACH. Les registres de Perl ont enregistré indifféremment les gens de Perl ainsi que ceux d'APACH. Aussi ne peuvent ils pas nous être utiles pour faire une liste composée exclusivement de noms de personnes ayant vécu à APACH.
Comme les registres paroissiaux ne peuvent pas nous apporter de précisison à ce sujet, il faut se reporter aux registres d'Etat-Civil. Mais ceux-ci ne commencent qu'en 1803. On trouvera également à la fin du cahier de doléances la liste des personnes qui prirent part à la rédaction de celui-ci.
En compulsant les registres de l'Etat Civil de 1803 à 1813, on a une idée des noms des familles qui vivaient à APACH à l'époque. Voici la liste recueillie:
APACH, BARTEL, BENDER, BLICK, BRAUNSHAUSEN, BURCHER, DIREN, CLOPE, DUNOT, FRANIEN, FEDERSPIL,RANCK, GOERGER, GREGOIRE, GUERIC, JAOBY, GLOUDEN, GREFFERATH, GROPE, JON, KAUFMAN, KLEIN, KEISER, KROMPHOLTZ , KREMER, LISCHE, LARY, LARRIN, MULLER, HEINZE, HOFFMANN, NIDERCORNE, RONCK , NOSBAUM, REDLINGER, RHEIN, RITE, ROSIER, REISHOFFER, SONDAG, SCHOUMACKER, SCHMIT, STRAUS, STEIN, SCHILTZ, THEIL,SCHÜTZ, THOMAS, WEBER, VEINGERTENER, VONZOM, WEIMERKIRCH, ZEREN.
On a vu qu'APACH était déjà à l'époque de l'ancien régime siège d'une mairie. On n'a malheureusement aucune trace du nom de ces maires d'avant la Révolution à cause de la destruction des archives pendant la tourmente révolutionnaire. La liste complète des maires de 1793 à nos jours est par contre connue. Bien entendu, il n'y a pas de maire entre 1812 et 1833 puisque pendant cette période, APACH n'était qu'une annexe de la commune de Kirsch.
LISTE DES MAIRES D'APACH.
1793 - 1794 : Michel SONDAG.
1794 - 1798 ; Christophe LARY.
1798 - 1799 : Jacques SONDAG.
1799 - 1800 : Michel SONDAG.
1800 - 1812 : Jacques SONDAG.
1812 ; Jacques REYMERINGER.
1823 - 1840 : Michel LARY.
1840 - 1857 : Michel GREGOIRE.
1857 - 1860 : Joseph BRON.
1860 - 1865 : Henri GREGOIRE.
1865 - 1871 : Mathieu GREGOIRE.
1871 - 1894 : Pierre CLOSSE.
1894
- 1917 ; Henri GREGOIRE.
1917
- 1920 ; Jean-Baptiste WEBER.
1920
- 1925 ; Jean SCHMITT.
1925 - 1935 ; Jean-Baptiste WEBER.
1935 - 1940 : Mathieu GREGOIRE.
1945 - 1947 ; Pierre ROLINGER.
1947 - 1953 ; Mathias HOFFMANN.
1953 - 1960 : André MATHEY.
1960 - 1971 ; Pierre MORITZ.
1971 – 1986 ; Pierre HALLE.
1986 - ; Gérard Rollinger.
Avant la révolution, APACH faisait partie de la paroisse de Perl , laquelle dépendait à son tour du chapitre de la cathédrale de Trèves. Sa dénomination exacte est "annexe de la cure de Perl, doyenné de Perl, archidiaconé de Tholey, diocèse de Trèves. I1 existait à APACH une chapelle dédiée à Saint léonard, patron des forgerons. I1 semble que cette chapelle fut fondée par Louis de Bettainvillers au moment où il établissait les forges d'APACH parce que ses ouvriers venaient de la Lorraine romane et qu'ils ne comprenaient que le roman. Les gens d'APACH se rendaient à Perl où la messe était en allemand. La chapelle eut une destinée différente de celle des forges et ne disparut pas avec celles-ci; elle continua au contraire
d'exister pendant tout le cours du 18e siècle. La chapelle d'APACH dépendait de la paroisse de Perl où se passaient tous les actes de l'Etat civil ; le chapelain n'y remplissait qu'un rôle intermittent, dans les cas urgents. ou pour des cérémonies particulières, telles que les fêtes commémoratives.Ce qui explique qu'on ne retrouve pas trace d'un bénéfice à APACH pour le chapelain.
Au début du 19e siècle, APACH fut détaché de Perl et devint une paroisse à part entière. C'est en 1804 qu'elle fut érigée en succursale communale de l'évêché de Metz, puis en 1808, elle devint une annexe de la paroisse de Kirsch. De 1826 à 1839, c'est une annexe vicariale de Kirsch. Elle prend en 1839 le titre de succursale de la cure de Sierck.
L'église actuelle a été construite en 1832, comme l'indique le linteau au dessus de la porte. Elle est dédiée à Saint Donat. L'église à été construite sur l'emplacement de la chapelle de Louis de Bettainvillers dont le clocher existe encore. L'une des deux cloches baptisée en 1827 porte le nom du patron Saint Léonard. I1 existe encore une chapelle dans le hameau de Belmach et une autre dans le hameau de Haut-Apach.
Voici à présent la liste des curés titulaires d'APACH depuis 1802.
1802 - 1806 : Joseph ZULION.
1806 - 1813 : Henri PIGEOT.
1813 -'1823 : Le desservant de Kirsch.
1823 - 1839 : Antoine LEIBER.
1839 - 1848 : Jean LAUER.
1848 - 1853 : Jean MARCHAL.
1853
- 1856 : Jean Adam VARIS.
1856 - 1867 : Jean-Pierre RICHERT.
1867 - 1876 : Pierre SICHEL.
1876 - 1884 : Nicolas ETTINGER.
1884 - 1888 : Michel LANGBOUR.
1888 - 1890 : Pierre KINTZINGER.
1890 - 1891 : Le desservant de Kirsch.
1891 - 1903 : Charles Louis MARITUS.
1903 - 1906 : Le desservant de Kirsch.
1906 - 1920 : Paul Lucien BILLER.
1920
- 1926 : Jean GREFF.
1926
- 1933 : Joseph HALTER.
1933 - 1934 : Le desservant de Contz.
1934 - 1935 : Nicolas PIERRET.
1935 - 1948 : Auguste SENSER.
1948 - 1958 : Jean ALBERT.
1958 - 1959 : Pierre FROMHOLTZ.
1959 : Marcel WEYLAND.
Assemblée du 6 mars en la chambre ordinaire par-devant Jacques LARUE, vigneron et premier élu de la municipalité, comme président l’assemblée pour l’empêchement du syndic ; pas de publication au prône, mais seulement par le greffier municipal.
43 feux. 43 comparants; 22 signatures.
Députés : Nicolas FRANCIN et Jacques LARUE, tout deux vignerons.
CAHIER DE PLAINTES, DOLEANCES ET REMONTRANCES des habitants et communauté composant le village d'APACH,dressé cejourd'hui dans l'assemblée générale convoquée au dit lieu en la manière accoutumée en la maison du syndic, en exécution des lettres du roi du 24 janvier dernier et réglement y joint et de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Thionville du 28 février aussi dernier ; à la rédaction duquel cahier a été procédé et a été résolu de faire les demandes et doléances qui suivent :
ART. ler. L'abolition entière de la gabelle, de la régie des cuirs et du pied fourchu.
ART. 2. L'abolition des privilèges et exemptions de l'ordre du clergé et de la noblesse.
ART. 3. L'abolition des exemptions des officiers de justice et autres.
ART. 4. La suppression des juridictions d'exception, comme bureau des finances et maîtrise des eaux et forêts, et réunir leurs fonctions aux juridictions royales.
ART. 5. La stabilité du parlement dans la province pour soutenir et maintenir les droits du roi et ceux du peuple et prévenir l'Etat de toutes incursions domestiques.
ART. 6. Que les frais de justice qui sont excessifs soient modérés; à l'effet de quoi, que les offices ministériels dans chaque siège soient réduits aux vacations arrivant.
ART. 7. Que l'administration de la justice soit établie d'une manière claire et succincte, et qu'il n'y ait dorénavant que deux degrés de juridiction y compris les hautes justices et que les premiers juges puissent juger en dernier ressort des choses n'excédant pas 100 livres, et pour cet effet qu'ils soient au nombre de trois.
ART. 8. Que la prévôté de Sierck soit érigée en bailliage, comme l'ont été les iutres prévôtés moins importantes dans la province.
ART. 9. Que l'art. XXII de l'édit du mois d'avril 1695 soit rapporté, et qu'il soit ordonné que les églises paroissiales seront entretenues et bâties par les décimateurs qui en étaient attenus avant le dit édit.
ART. 10. Que l' administration des biens ecclésiastiques en commende soit retirée aux abbés commendataires aux vacations arrivant, et les dits biens réunis aux abbayes et prieurés qui les concernent, à charge par eux d'employer la moitié du revenu en entretien des bâtiments et de verser l'autre moitié des revenus aux économats de chaque province, sauf à Sa Ma-
jesté d'en régler une pension fixe à proportion du revenu, mais qui ne pourra pas excéder le tiers, pour les abbés commendataires que le roi voudrait en gratifier, le surplus des mêmes revenus devant être employé aux réparations des églises qui seraient à la charge du peuple, hors d'état d'en faire les frais en tout ou en partie, et à l'établissement d'un collège de régents et régentes d' école pour l'instruction des enfants du plat pays, et autres oeuvres pies.
ART. 11. Que cette province demeure exempte de l'établissement des barrières, et que la liberté de commerce avec le pays étranger limitrophe soit maintenue en conformité des traités souverains depuis l'époque du 3 mars 1325 jusqu'à celui de Paris du mois de janvier 1718.
ART. 12. Que les propriétaires de chaque paroisse ainsi que les décimateurs soient tenus à contribuer au soulagement des pauvres.
ART. 13. Que la province soit mise en pays d'Etats.
ART. 14. Que l'exportation des bois (hors le pays français) soit généralement défendue, parce que cette exportation fait la plus grande cherté dans nos contrées destituées des moyens bursaux, et que cette défense soit faite tant dans la Lorraine, qui est pays limitrophe, que dans la prévôté de Sierck.
ART. 15. Que la grande multiplicité des droits d'acquits d'entrée et de sortie dans la Lorraine soit abolie aux fins que les étrangers limitrophes d'ici puissent acheter les gros fruits dans nos contrées, surtout des vins, qui restent dans le pays à cause des dits droits, de façon que les habitants ne sont presque pas en état de payer les deniers royaux faute de leur sortie.
ART. 16. Que le vingtième qui est sur les habitations de la communauté en général soit aboli; ainsi que l'abolition des droits onéreux qu'on à mis sur des espèces de pressoirs que chaque habitant vigneron n'a que pour son propre usage, les dits droits imposés depuis environ douze ans, et vu que les dites habitations sont chargées de cens en avoine envers Sa Majesté.
Fait et arrêté en la maison du syndic du village d'Apach, au dit Apach, en l'assemblée générale du dit lieu, le 6 mars 1789, et ont signé tous ceux des habitants qui savent signer, suivant l'ordonnance :
N. FRANCIN; Hari GREGOIR; Hari KROMPHOLS; Adam KLASS; Henrig STEIN; Johannes Battis GORG; Jacob GOERG; Michel SONDAG; Jacob LARI; Christoffel LARI; Friderich GEOERG; Johannes GBRG; Anton KLEIN; Jacob MOLLER; Christtyan SONDAG; Johannes AUSTGEN; Pierre WILD; Michel KLASS; Johannes HELLENDORF; Michel SONDAG; Mathias ABACH; Jakob SONDAG.
Les comparants qui n'ont pas signé sont J. THEOBALT; J. LICHE; Christophe MULLER; Adam DIREN; Jos. THOMAS; Michel CREYER; Jacq. THEOBALT; Jacq. LICHE; Mathias BOUCHY; J. RONCK; Hubert ACKER; J. GREGOIRE; Pierre SIMINGER; Mathias BRAUNSHAUSEN; J. DAX; J. HOFFMANN; J. SCHMITT; Mathias SCHUTZ; Jacq. SCHUTZ; Mathias SIMINGER; Henri DIREN.
Pierre WILD qui a signé n' est pas compté parmi les comparants.
Il y a peu de croix sur le ban d'APACH. Nous n'en n'avons relevé que TROIS : une à APACH sur la route de BELMACH, une seconde au HOVERT, une troisième en bois à l'entrée de BELMACH
La plupart des maisons d' APACH ont été refaites, surtout après le bombardement de novembre et décembre 44. De plus, ces vingt dernières années, de nombreuses personnes ont enlevé systématiquement leurs linteaux pour mettre des portes en plastique. De rares façades ont conservé leurs linteaux d'origine. Voici en exemple un linteau daté de 1850 qui se trouve au mur d'une maison de la rue nationale. Il est très sobre car il ne comporte que la date de construction de la maison et le nom de la personne qui la fit construire: KATHARINA FRANS.

---DELAMOSELLE - La belle histoire d'Apach. Paul Even, Metz
---J. FLORANGE - Aperçu historique sur Apach et ses forges. Paris 1910
---Revue Culturelle du Pays francique
| Retour sommaire |